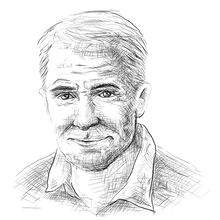--------------Laon et son histoire--------------
Laon

Les début de la vie de notre belle ville
Le promontoire de Laon fut occupé dès la préhistoire comme l’atteste la présence d’un habitat antique dans des cavernes creusées au sein même des falaises. Ces demeures troglodytes encore visibles aujourd’hui sont appelées les « Creuttes » ou « Crouttes ». Avec ses nombreuses sources d’eau, le site aurait été un lieu privilégié des druides celtes, un « promontoire sacré ». Le nom romain de Laon a d’ailleurs une origine celtique. En effet, au IVème siècle (entre 357 et 363 avant notre ère) sous le règne de Julien l’Apostat, une forteresse est édifiée par les Romains sur la petite montagne de Laon. La situation idéale du site n’avait pas échappé aux Romains qui y implantèrent un fort leur permettant de surveiller la plaine. Ils attribuèrent au promontoire le nom de Laudunum ou Lugdunum, provenant du dieu Lau ou Lug, divinité celtique du V ème siècle avant J.C. Cet acte s’inscrivait dans la politique de l’empereur romain Julien consistant à donner une nouvelle impulsion aux cultes gaulois et à s’opposer à la montée du christianisme que Julien voyait d’un mauvais œil.LAON SOUS LES MÉROVINGIENS L’histoire de Laon fut par la suite étroitement liée aux Mérovingiens, dynastie des rois francs. Elle fut un des lieux de résidence de Clovis et de son épouse Clotilde. Cette reine chrétienne fit construire un oratoire dédié à Saint-Marcel dont un quartier de Laon porte aujourd’hui le nom. C’est également à Laon que le célèbre Saint-Rémi fut élevé avant d’être ordonné évêque de Reims. La ville accueillit par ailleurs Sainte-Geneviève en 480, connue pour avoir défendu Paris contre les Huns. Elle y aurait guéri une jeune fille paralysée.La ville fut aussi témoin des affrontements qui opposèrent les deux frères rivaux Chilpéric et Sigebert et leurs épouses respectives Frédégonde et Brunehaut. Chilpéric et Sigebert étaient les petits-fils de Clovis Ier. Le partage des terres entre les frères à la mort de leur père fut à l’origine d’un incessant conflit relaté par deux historiens du VIème siècle, Fortunat et Grégoire de Tours.

Chilpéric était roi de Soissons tandis que son frère Sigebert, roi de Reims, possédait Laon, Metz et l’est de la Gaule formant l’Austrasie. Sigebert sera finalement assassiné à Vitry en 575, probablement sur ordre de Frédégonde. Cet assassinat ne mit cependant pas fin à l’affrontement. Chilpéric et Frédégonde devaient toujours faire face à la reine Brunehaut, à présent veuve de Sigebert. Or la reine s’avéra être un adversaire politique hors du commun. Elle survivra au couple royal pour finalement être exécutée à l’âge de 70 ans en 613 par Clotaire II, fils de Chilpéric et Frédégonde. Brunehaut laissa une trace importante à Laon. Elle y avait sa résidence. La reine qui s’était convertie au christianisme pour son mariage construisit à Laon l’abbaye Saint-Vincent.Si Laon ne fait pas partie des plus grandes villes de France, elle fut pourtant une cité royale, résidence favorite des rois Carolingiens (741-895) avant de brièvement devenir la capitale du Royaume de France (895-988) LAON DEVIENT RÉSIDENCE ROYALE SOUS PÉPIN LE BREF
Vue de Laon depuis la cuve Saint-Vincent Vue de Laon depuis la cuve Saint-Vincent L’histoire de Laon sous les Carolingiens débute avec la mort de Charles-Martel, le célèbre maire du palais qui battit les Sarrasins à Poitiers. Il laissa derrière lui trois fils, Carloman, Pépin et Griffon, fils illégitime. Ce dernier fut rapidement évincé par Pépin qui, avec la complicité de Caribert comte de Laon et père de la future Berthe « au Grand Pied », s’empara de Laon et emprisonna son demi-frère. Carloman ayant de son côté choisi de rentrer dans les ordres, Pépin resta seul maître à bord et Laon devint sa résidence royale. Laon serait également là où Charlemagne aurait été conçu, dans la forêt de Samoussy.

En 754, le pape Etienne confirma la dignité royale à Pépin accordée trois ans avant par le Pape Zacharie. En 768, Pépin le Bref décède et son royaume est partagé entre Charlemagne et son frère Carloman. Mais ce dernier meurt quelques années plus tard en 771 laissant Charlemagne régner seul.Laon a également accueilli en son sein, Roland, neveu de Charlemagne et héro de la fameuse « chanson de Roland ». A la mort de Charlemagne, son fils Louis lui succèda. Le nouveau souverain est très dévot et sera d’ailleurs surnommé « Louis le Pieux ». Une dévotion qui ne l’empêchera pas de choisir en seconde noce après la mort de son épouse Hermangarde, la belle Judith sélectionnée après avoir fait défiler dans son palais les plus belles jeunes filles de l’empire.Louis et Judith auront un fils, le futur Charles le Chauve. Mais l’enfant né en seconde noce ne peut prétendre au trône. S’ensuit alors un conflit qui opposera Judith et Lothaire, fils du premier lit, qui s’achèvera par l’exil de Lothaire en Italie et le retour de Charles à Laon après avoir été momentanément enfermé dans le monastère de Prum près de Trèves. En 840 Louis le Pieux décède. Charles sait alors qui lui faudra agir vite face à ses demi-frères pour récupérer sa part du royaume.
Mais l’opposition qui règne entre les demi-frères vire au carnage sur un champs de bataille opposant Lothaire et Charles. Charles ressortit vainqueur, se fit couronner à Reims et prit possession de son royaume de Laon, Soissons, Reims, Saint-Quentin et Paris. Mais le nouvel empereur doit faire face à trois menaces conjointes lors de son règne : les Sarrasins sur les côtes méditerranéennes , les Bulgares et les Normands qui ravagent les côtes dans le Nord. Si Laon du haut de ses remparts est protégée, ses habitants voient au loin l’abbaye de Saint-Vincent victime des flammes. Malgré ces menaces guerrières, Laon devint un grand centre culturel sous l’impulsion de Charles le Chauve.
CHARLES LE SIMPLE FAIT DE LAON LA CAPITALE

du royaume Quelques années plus tard, Charles le Simple, petit-fils de Charles le Chauve, fit de Laon la capitale de son royaume. Mais le roi dut faire face à la trahison de seigneurs rebelles qui lui tendirent une embuscade et l’emprisonnèrent. Le roi meurt emprisonné en 929. Héribert, le leader de la mutinerie, s’empare de Laon. La reine Otvige, épouse de Charles, s’était enfuie en Angleterre près de son père, avec son fils Louis surnommé « Louis d’Outre-mer ». Le duc Hugues (grand-père d’Hugues Capet) décida alors sous couvert de préserver le sang royal, de faire rappeler le jeune prince. En réalité le duc pensait pouvoir contrôler le jeune homme de 15 ans et manœuvrer à travers lui. Bien mal lui en prit ! Le jeune roi reprit son royaume en main et s’affranchit rapidement de la tutelle du duc. Ce dernier, furieux, décida de se rallier au traître Héribert toujours présent à Laon, dans la citadelle du château-Gaillot. Louis fit alors le siège de la forteresse dont il s’empara rapidement grâce à une efficace machine de guerre qui mit à mal les murs de la citadelle. LE RÈGNE DE LOUIS D’OUTRE-MERE 930
Louis d’Outre-mer épouse Gerbère, veuve du duc de Lorraine possédant la Belgique. Il put ainsi agrandir son royaume. Mariage politique, les deux époux formèrent pourtant un duo travaillant à une même oeuvre politique et faisant front face aux risques de trahison des grands seigneurs. Il auront ensemble plusieurs enfants dont Lothaire, futur roi de France. Mais de nombreux ennuis attendent encore le roi Louis. En 945, alors qu’il essaie de récupérer la Normandie, le roi est emprisonné par les seigneurs normands qui réclament en échange de la liberté du roi, ses deux fils. Seul le second fils, alors un nourrisson qui ne survivra pas, est livré. Le roi est libéré mais est de nouveau fait prisonnier par le prince Hugues qui réclame quant à lui la ville de Laon en échange de la liberté du roi. La reine Gerbère qui dut céder la ville fit appel au roi d’Angleterre (également l’oncle de Louis) et à son frère Othon de Germanie. Le roi fut libéré et la ville de Laon récupérée grâce à un astucieux stratagème.

Les soldats du prince se firent passer pour les palefreniers de Hugues qui menaient chaque jour les chevaux au pâturage en dehors de la ville. Ils parvinrent ainsi à pénétrer dans la ville et à ouvrir l’accès aux troupes du roi Louis. Mais en septembre 954, le roi meurt accidentellement d’une chute de cheval à l’âge de 33 ans. Il est enterré à Saint-Rémi où reposent les rois de Laon.

LA FIN DES CAROLINGIENS
Cathédrale de Laon La reine Gerberge doit alors faire rapidement face au danger des seigneurs rivaux et assurer le couronnement de son fils Lothaire alors âgé de 13 ans. Elle fit de nouveau appel à son frère Othon de Germanie mais également à son second frère Brunon archevêque de Cologne. Elle parvint avec ces alliés de taille à forcer le prince Hugues à reconnaître Lothaire en tant que roi et à le faire sacrer à Saint-Rémi. Gerberge a triomphé et sauvé la dynastie. La politique du nouveau roi s’attachera notamment à repeupler les régions dévastées par les incursions normandes et sarrasines. Mais en 986 le roi tomba malade et décéda brutalement. On murmure qu’il aurait été empoisonné par ses ennemis, de même que son fils qui ne lui succédera que très brièvement. En effet, ce dernier mourut à son tour un an après de maladie soudaine. Il passera à la postérité sous le surnom de « Louis le Fainéant » donné par ses ennemis. En effet, seul le mot « néant » pouvait être associé au mot « fait » face à un règne si court S’ensuit alors un conflit de succession. Le duc Hugues, futur Hugues Capet, écarta du pouvoir Charles, frère de Lothaire. Hugues est proclamé roi le 1er juin 987 à Noyon. Mais Charles tenta de renverser la situation et s’empara de la ville de Laon. L’évêque Adalbéron allié d’Hugues Capet est arrêté ainsi que la reine Emma, veuve de Lothaire, pour l’écarter du pouvoir.

Charles renforça les fortifications de la ville. Hugues et ses alliés tentèrent à deux reprises d’assiéger Laon, sans succès. Le combat d’Hugues Capet aurait pu être perdu si l’évêque Adalbéron n’était pas entré en scène. L’évêque qui avait rallié Hugues Capet implora le pardon du roi Charles et lui promit fidélité. Mais la nuit même, Adalbéron ouvrit la porte de la ville aux soldats d’Hugues Capet qui pénétrèrent dans la cité et s’emparèrent du roi. Ce dernier mourut en prison dix mois plus tard. Ainsi s’acheva l’histoire des Carolingiens et débuta celle de la dynastie capétienne. Les Laonnois considérèrent cependant pendant longtemps le nouveau roi capétien comme un usurpateur et restèrent fidèles aux Carolingiens. Quant à l’évêque, il mourut peu de temps après sa trahisonLa ville de Laon que l’on a supposée, mais à tort vraisemblablement, être l’ancienne Bibrax de César, a joué un rôle très important dans l’histoire de France, et ses destinées furent presque continuellement mêlées aux destinées générales de notre patrie. Bâtie sur une éminence et près de la frontière, au milieu d’une plaine d’où elle peut être aperçue de fort loin, elle a toujours été par sa position même une place importante. S’il faut en croire l’historien Devismes, elle comptait déjà deux siècles d’existence, lorsqu’en 407 elle subit un siège en forme contre les Alains, les Suèves et les Vandales, qui finirent par la ravager.Elle fut aussi assiégée par Attila, qui échoua devant ses murs, défendus par Aétius et Théodoric. Bientôt après saint Rémy, évêque de Reims, qui était Laonnais, invita ses compatriotes à se soumettre à Clovis ; et en l’an 500, avec l’autorisation d’un concile provincial, il érigea la petite division de Thierasche, où se trouvait la ville, en diocèse dont Laon fut le chef-lieu. Il dota lui-même l’évêché et le chapitre de son propre bien, et lui conféra le domaine d’Anisy, qui valut à ses évêques le titre de comtes. C’est ainsi que s’explique la réunion des deux pouvoirs spirituel et temporel que l’on remarque dans l’histoire de ce diocèse Le séjour de Laon était fort affectionné de nos rois de la deuxième race, qui en firent leur capitale.

C’est là que vint se retirer Louis d’Outremer, peu après son élection à la royauté : il fit construire la tour dont nous avons parlé.L’histoire de la ville de Laon, pendant les douzième et treizième siècles, est remplie par les guerres de la commune. Les habitants eurent à subir une lutte des plus longues et des plus pénible pour le maintient d’une constitution de commune analogue à celle de Beauvais. Ils furent tantôt secourus tantôt accablés par les rois de la troisième race, qui leur vendirent souvent leur appui, mais qui souvent aussi, au mépris de leurs propres antécédents et de ceux de leurs prédécesseurs, cédèrent aux conseils et surtout aux libéralités des évêques et princes de Laon. Lorsque Philippe-Auguste réduisit à douze le nombre des pairs de France, jusqu’alors illimité comme celui des hauts barons, l’évêque de Laon fut l’un des douze pairs, dont six étaient laïques et six ecclésiastiques ; il portait la sainte ampoule au sacre des rois, et cette dignité lui fut conservée jusqu’en 1793. Au temps des troubles fâcheux qui suivirent la captivité du roi Jean, Robert Le Coq, député de Laon dont il était aussi évêque, se rendit célèbre par les séditions qu’il fomenta dans la capital, et dont le dauphin faillit à être la victime. Ensuite il retourna dans son évêché qu’il voulut livrer à Charles-le-Mauvais, roi de Navarre ; mais repoussé par les habitants et privé de son siège, il se retira à la suite de ce prince qui lui fit donner l’évêché de Calahorre dans le royaume d’Arragon. En 1418, Laon tomba au pouvoir de Jean sans Peur, duc de Bourgogne, ligué avec Isabeau de Bavière, et fut en proie aux plus affreux désordres.

Son vénérable évêque, Jean de Roucy, fut impitoyablement massacré dans sa prison par la populace révoltée, qui fit partager le même sort à 2 archevêques, 6 évêques, et quantité de personnages les plus recommandables. L’année suivante, la ville fut livrée aux Anglais ; mais en 1429, lorsque Charles VII, sous la conduite de Jeanne d’Arc, vint se faire sacrer à Reims au travers des provinces occupées par l’étranger, Laon suivit l’exemple de plusieurs autres villes, chassa la garnison anglaise, et ouvrit ses portes au roi de France.En 1544, ce fut près de Laon que fut signé, et à Laon que fut d’abord publié le traité de Crépy qui mit fin à la rivalité de François Ier et de Charles V. En 1560, la religion réformée s’acquit parmi les Loannais de nombreux partisans, et la guerre civile ne tarda pas à éclater entre les protestants et les catholiques, comme dans la plupart des villes de France. Laon envoya, pour député aux états-généraux qui se tinrent à Blois, sous Henri III, en 1576, Bodin, auteur fameux par son érudition. Il y parla en faveur des idées populaires, et mérita d’être nommé par excellence l’orateur des estats. En 1589, la ville de Laon suivit le parti des ligueurs. Elle y déploya une ardeur qui ne fit que s’accroître à la suite de l’assassinat du duc de Guise. Henri IV, en 1590, assiégea vainement cette ville fidèle au parti de la ligue, qui avait alors pour chef le duc de Mayenne ; mais après la reddition de Paris, Laon ne tarda pas à capituler. Lors des troubles de la minorité de Louis XIII, après l’emprisonnement du prince de Condé, cette place tomba au pouvoir du duc de Vendôme, l’un des mécontents ; et plus tard, la politique anti-féodale, mais hautaine et despotique, du cardinal de Richelieu, rencontra dans cette ville une vigoureuse résistance. En 1668, Laon, qui devait subir toute espèce de fléaux, fut désolé par une peste et une famine affreuse qui donnèrent occasion de se signaler au dévouement de son évêque 20ésar d’20strées.Au début du XIXe siècle, Laon eut sa part des malheurs de la France, en particulier en mars 1814. Napoléon, croyant l’armée de Blücher engagée dans un mouvement décousu, espérait lui enlever Laon par une attaque brusquée ; mais au contraire il s’y heurta contre cet adversaire disposant de toutes ses forces, et posté avantageusement sur la montagne inexpugnable de Laon. Pendant trois jours les attaques se succédèrent ; mais Blücher ne fut point entamé, et conserva ses positions
.1856-1857 : construction de la gare de Laon, agrandissement en 1898.

Destruction lors de la guerre 14/18 puis en 1944. Reconstruite.1857 : mise en service de l'escalier Municipal; c'est le chemin le plus direct pour accéder au plateau (à pied).1899 : le 09-07 inauguration de la liaison ville haute-ville basse par un tramway à crémaillère. Arrêt de la ligne pour raison de sécurité en 1971.1914 /1918 : 1° guerre mondiale, la ville est occupée par les Allemands le 02 septembre 1914, libéréele 13 octobre 1918. Privations importantes pour les Laonnois pendant cette période ; seulement 4350 habitants environ sont encore là en octobre 1918, pour 16000 au début du conflit.1939 / 1945 : 2° guerre mondiale, mai 1940, la France est envahie, Laon passe sous le joug Allemandjusqu'en septembre 1944. Les bombardements alliés du printemps 1944 feront beaucoup de dégâts, enparticulier du côté de la gare.1989 : ouverture au public (après 10 ans d'étude, construction et essais) du mini-métro Poma 2000 qui reprend le tracé du tramway. Bien que rendant service à beaucoup de Laonnois ce mode de transport ne sera probablement jamais rentable.2005 à début 2008 : la façade de la cathédrale a droit à un lifting, les autres parties de l'édifice en ? .2008 : incendie de l'abbaye Saint-Vincent (logis abbatial).De 1988 à 1993 et après 1997 le Député de la circonscription est Monsieur René Dosiére (apparenté PS).Ancien Maire (1983 à 1989). Né en 1941.Depuis 2001 le Maire de la ville, est Monsieur Antoine Lefèvre (UMP), élu Sénateur en 2008. Né en 1966 et en suite je n est plus d info sur notre ville.
Frédéric Bellens
Le docteur Mestrude mobilisé à 68 ans témoigne…
Rapport de captivité de Monsieur le médecin-major de 1ère classe [Antoine Marie Ferdinand] Mestrude
(1846-1921) de l'A[rmée].T[erritoriale]. Médecin-chef des salles militaires de l'Hospice mixte (hôtel Dieu) et de la Place de Laon.

Le 3 août (2e jour) je prenais possession de mon poste [de médecin-chef des salles militaires de l’hôtel Dieu de Laon]. Mon prédécesseur M. [le médecin major de 1ère classe] Eugène Meyer

[1867-1933] était parti de la veille - J'eus donc à me préoccuper de trouver immédiatement, dans les archives, tout ce qui concernait la mobilisation (perte de temps). Même jour arrivée de 22 Infirmiers ou plutôt de réservistes et territoriaux des services auxiliaires de toutes provenances dont, à part 3 ou 4 exceptions, je n'ai jamais rien pu tirer. Se présentaient également deux médecins civils : MM Predhomme [de Laon] et Peyron [de Montcornet] ; un étudiant en fin d'études, M. Fortier. Le pharmacien aide major de 2e classe de l'Armée.Territoriale. M. Cahen. Pour le logement, la nourriture des hommes je rencontrai, dès le 1er jour, la plus parfaite mauvaise volonté chez Monsieur l'économe directeur, elle ne cessa que le jour de notre départ pour l'Allemagne.
Je ne lui trouve comme excuse que l’ignorance dans laquelle il était de l‘arrivée d'un pareil contingent. Je ne reviendrai plus sur ces auxiliaires qui m'ont donné beaucoup de tracas en raison de leur indiscipline, de leur grossièreté, etc. ; on aurait juré qu'ils avaient été choisis. J'en ai retrouvé quelques-uns en Allemagne qui se sont singulièrement assoupli et me l'ont avoué. Bref ce fut une erreur. Quelques jours après, sur l'offre du Général commandant la Place, je choisis au 45ème d'Infanterie,
5 réservistes ayant fait des stages dans les salles militaires à Laon. Je n'eus qu'à m'en louer et c'est grâce à eux que le Service a pu fonctionner normalement. Je considère comme un devoir de le dire. Un infirmier de la 2ème section [d’infirmiers militaires] prévu et annoncé, n’a jamais paru. Je puis dire que tout le mois d'août se passa en grands mouvements de malades, en commissions spéciales de réforme qui auraient pu siéger en permanence ; c'était prévu.

J'arrive au premier contact avec les Allemands. Les premiers blessés allemands arrivent le 18 août - 1 capitaine de Dragons et 2 soldats de la Garde. J'eus beaucoup de peine à arracher le premier à la curiosité malveillante de mon personnel civil. Je le conduisis le jour même, à l'infirmerie du lycée (Hôpital temporaire n° 3). Les 2 soldats furent placés dans un cabinet éloigné, dans le quartier des Civils. Je n'ai pas pu les évacuer avant l’arrivée des Allemands, à mon grand regret. La Prévôté s'est occupée du capitaine. Le 27 août un télégramme de la direction me prescrit, en cas de repliement, de rester et de donner des ordres en conséquence. Aux autres formations de la Place - Arrivée de [M. le médecin] aide-major Moulineau. Le 31 août les autorités militaires ont quitté la Place. L’arrivée et l'évacuation des blessés battent leur plein. Je résumerai aussi le mouvement d'évacuation. J'ai reçu 16 officiers blessés, fin août ; pas un n'est tombé entre les mains des Allemands mais il était temps, et si j'eusse eu quelques automobiles de plus, beaucoup de ces blessés ne seraient pas en Allemagne actuellement. 2 Septembre. - Arrivée des Allemands. C'est le 2 septembre que les Allemands occupèrent la ville haute. Depuis la veille, au matin les communications postales et télégraphiques étaient interrompues. Dans la journée beaucoup de soldats et d'officiers allemands viennent se faire panser. Pas de médecins. - On devine un certain désordre.

Témoignage du docteur Peyron Je faisais partie du personnel des salles militaires de l'hospice mixte de Laon. La ville de Laon fut occupée par l'ennemi le 2 septembre. (Quelques jours avant l'arrivée des Allemands on apporta à l'hôpital les civils blessés, quelques-uns grièvement. Il y avait parmi eux un garçon de 15 ans. Ils racontaient que les Allemands les avaient forcés de faire des tranchées, puis les avaient fusillés à distance. Trois ou quatre avaient été tués sur place. Nous avions en ce moment dans nos salles quelques centaines de blessés français, des blessés anglais et quelques allemands. Les premiers jours furent calmes. Pas d'incidents. Des officiers allemands vinrent visiter leurs blessés, s'assurèrent qu'ils étaient bien traités - et ce fut tout. Puis on nous confia de nouveaux blessés, allemands pour la plupart. (A plusieurs reprises, pendant ces premiers jours d’occupation, les Allemands nous témoignaient toute leur satisfaction des soins que nous donnions à leurs propres blessés.) Peu à peu les Allemands organisèrent leurs services. Ils nous retirèrent alors leurs soldats et nous laissèrent en traitement les Français et les Anglais. Nous fûmes bientôt relégués, avec nos blessés, dans les salles les plus étroites ; les salles les plus vastes et les mieux aérées, les salles d'opération les mieux installées étant réservées aux services allemands. Ils s'emparèrent ainsi de la partie la plus belle de l'hospice civil, dont ils évincèrent les occupants. Je me contente de signaler qu'à plusieurs reprises des médecins allemands pénétrèrent dans nos salles, sous prétexte de visites d'inspection, accompagnés d'un peloton de soldats en armes baïonnette au canon. (Au reste tous les infirmiers allemands étaient armés et il leur arrivait même de faire le coup de feu de l'intérieur de l'hôpital sur les aéroplanes français et anglais qui survolaient la ville.) [extraits du rapport du médecin aide-major R. Peyron]. Le 5 septembre. - Visite du service des Etapes qui s'enquiert de mes ressources et passe partout. Des groupes d'officiers viennent demander à prendre un bain ; il est satisfait à leur demande autant que possible. Ils ne font que passer. 6 septembre. - 85 blessés allemands entrent à l’hôpital à 4 Heures du soir. Aucun médecin ne les accompagne, j’en suis très surpris.

7 septembre. - Quelques médecins isolés se présentent le matin - Dans la journée : visite d'un personnage accompagné du professeur Ppfeifer de Breslau que je verrai plusieurs fois et chaque fois courtois. - Visite de médecin-chef des ambulances. - Visite d'un groupe de médecins, escortés et serrés de très près par de nombreux infirmiers, l’arme au bras. Tous paraissent très pressés. Le Médecin-chef de l’artillerie de la Garde qui voit mon étonnement de pareilles mesures me dit qu’il en est ainsi depuis, qu’en Belgique, la population a tiré sur les blessés, les médecins et les brancardiers. Ces MM. passent rapidement, et m’annoncent qu’ils partent pour Fismes. Je dirai, une fois pour toutes, que dans toutes ces visites qui devinrent fastidieuses et nombreuses, je me fis prévenir immédiatement et tins essentiellement à accompagner les visiteurs dès leur arrivée jusqu’à leur sortie. Chacune de ces visites se termine par force éloges sur la façon dont nous traitons les Allemands qui sont d'ailleurs interrogés chaque fois dans ce sens. 8 et 9 septembre. - Unités d’autorités médicales. Désignation de blessés allemands évacuables. 10 septembre. - L’après-midi, tous les blessés allemands qui peuvent marcher ou se traîner, quittent l’hôpital sans ordre, isolément ; ils se dirigent paraît-il sur la gare où ils croient que se forme un train d'évacuation.Plusieurs reviennent mais, le soir il en manque 19. - Cette fuite correspond évidemment aux combats de la Marne que nous avons toujours ignorés. 11 [septembre]. - Evacuation continuelle par autobus de tous les Allemands même gravement atteints. On nous fait prévoir l'arrivée de centaines de blessés. Aussi les médecins désignent dans le quartier des Civils tous les locaux qu’il leur faut et font évacuer, au besoin, les salles qu'ils ont choisies.

12 septembre. - Un médecin-chef (M. Landesberger) est désigné pour prendre le service des Allemands. Parle bien le français et se montre et se montrera toujours un camarade serviable au possible. Arrivée dans l’après-midi de 19 officiers allemands blessés venant de Reims, à 5 Heures, 20 autres arrivent en auto : même provenance, je ne puis les recevoir tous, j’en dirige une partie sur l'hôpital temporaire . Ces officiers étaient soignés à Reims dans différents établissements ou cliniques comme ils me l'ont dit ; ils ont donc été enlevés précipitamment. La cause nous échappe toujours. 13 Septembre. - Il y a dû avoir une alerte car les deux dames de la Croix-Rouge employées aux officiers allemands fuient précipitamment sac au dos. Elles reviennent 1 heure après, très grand mouvement en ville. 16 septembre. - Grande évacuation par autos sur Chimay (les chemins de fer étant détruits) Le Prince de Reuss (qui n'est pas officier) en fait partie. 18 septembre. - Les Allemands me demandent d'évacuer 24 malades ou blessés français sur la caserne d'artillerie. 19 [septembre]. - Je reçois un capitaine français blessé à Corbeny. 21 [septembre]. - De nombreux blessés allemands (12 officiers) arrivent par autos. A Une Heure de l'après-midi à la suite d'un incident survenu dans une formation sanitaire en ville, des fonctionnaires sont placés à l'entrée et dans l'intérieur de l'hôtel Dieu - Je dois dresser un état nominatif de tous les Français en traitement - Je ne puis plus sortir qu'avec un laisser passer pour aller au lycée où je prends depuis longtemps mes repas avec mes camarades. Défense d'aller en ville. Je considère ma captivité comme datant de ce jour. J'en eus bientôt la preuve. 22 septembre. - M. le Directeur amène dans mon bureau le médecin-chef allemand et lui déclare qu'il sera très bien là pour surveiller les allées et venues. C'est l'expulsion sans protestation possible. J'ai à peine le temps d'emporter les documents les plus importants : (mobilisation, etc.). Je n'insiste pas sur ce procédé. 24 septembre. - Malgré les évacuations, toutes les formations sont pleines. Nous recevons les blessés français qui étaient en dépôt dans une caserne et sans pansements depuis 5 jours. Il est évident que les Allemands ne savent plus où loger leurs blessés.

Ils évacuent des amputés récents, les leurs comme les nôtres, il leur faut de la place à tout prix. Ils emploient les chemins de fer, mais avec transbordement, les ponts n’étant pas rétablis. J’apprends que le tétanos est très fréquent chez eux (EcoIe normale) Chez nous, deux cas le même jour. 25 septembre. - Nous recevons quelques blessés de Craonne et environs, blessés du 20. Il ne reste dans nos salles, grâce aux évacuations, que 73 Français et 11 Anglais. 1er octobre. - Les Allemands évacuent sans discontinuer des blessés arrivés la veille ou l'avant-veille et souvent gravement atteints. 2 octobre. - Nous avons failli avoir la visite de l’Empereur. Mais, il paraît que le spectacle qu’il a eu à l’Ecole Normale lui a suffi (témoignage d'une dame de la Croix-Rouge.) 4 octobre. - Les Allemands n’ont plus à l'hôtel Dieu que 76 blessés ou malades, et nous 85. Je prépare, par ordre, une évacuation de 25 Français. Les journées suivantes sont dénuées d'intérêt jusqu’au 17. 17 octobre. - Départ de nombreux infirmiers de la Croix-Rouge. Ils n’en emploient pas d'autres. Ces infirmiers annoncent qu’ils vont à Amiens, Dunkerque et peut-être même Calais. C’est la croyance du médecin en second qui part lui-même (Dr Kastan) dans quelques jours. Visite du Prince Max de Saxe. Il passe lentement dans nos salles et, en un langage dépourvu d'accent, réconforte nos soldats. Arrivé aux officiers il prononce cette phrase : " Je sais que la France ne voulait pas la Guerre". J'en fus quelque peu stupéfié. II prend les lettres ouvertes des blessés pour leurs familles. Jusque-là aucune correspondance n'avait pu sortir de l'hôpital. Pour clore ce petit incident j’ajouterai que quelques jours après, je reçus la visite d’une Excellence à qui je fis part de l’aimable visite du Prince. -- Ah oui ! répondit le haut dignitaire : Max de Saxe, beaucoup plus connu en France qu'en Allemagne.

19 octobre. - 25 malades sont désignés pour être évacués d'urgence,- mais ne partent pas. Le Docteur Kastan m'annonce que Laon a évacué pendant le mois 18.000 blessés. Bien que n'allant pas en ville je sais que la garnison de Laon est partie et remplacée complètement par de la landstrum. J’en sais assez, pour m'en rendre compte. Le départ pour Calais n’était pas un mythe. Le 19 octobre le personnel allemand est changé ; nous perdons avec regret le docteur Landesberger, qui va à Neufchâtel. II est remplacé par le docteur Manasse professeur à Strasbourg, spécialiste des maladies nerveuses et mentales. Il a pour adjoint un unterartz M. Spiro. Je n'eus aucun rapport de service avec ces MM [messieurs]. Nos relations aux rencontres furent toujours courtoises et plutôt rares. Comme je demandais à un pharmacien militaire du lycée, (M. Wahl), pourquoi il ne venait pas à l'hôtel Dieu voir son chef il me répondit : -. M. Manassé, à Strasbourg, cultive les sympathies françaises pour mieux les dénoncer. (textuel) Tout le personnel est donc renouvelé radicalement. Le mois d'octobre s'écoule dans la plus grande monotonie. Le 29 [octobre] je réclame un bureau chauffé et éclairé à la commission administrative et le 30 je prends possession d'un cabinet de consultation abandonné dont tout le matériel a été enlevé. C'est là que j'attendrai les évènements. Novembre 8. - Je demande au médecin-chef de la Place l'autorisation de visiter les blessés français de la Providence (Croix-Rouge Française). Elle m'est accordée. Je fais ma première sortie, en uniforme bien entendu. En sortant de cet établissement, je suis accosté par un jeune homme qui me dit dans le plus pur français : - "Je suis agent de la police secrète allemande ! Je désire savoir si vous avez le droit de vous promener en ville". En même temps il donne un coup de sifflet et un soldat s’approche. Je montre mon laisser-passer, et je conduis le bonhomme à la Kommandantur à deux pas. Bafouillage d'un officier subalterne et rentrée à l'hôtel-Dieu. M. [Georges] Ermant [1852-1935] sénateur-maire de Laon informé de cet incident écrivit à l’autorité militaire une lettre fort digne à laquelle, il ne fut probablement pas répondu (méthode allemande). 9 Novembre. - Des automobiles arrivent à l'improviste et un médecin de la Direction désigne 28 malades ou blessés français qui vont être emmenés au camp de Sissonne - ils partent à 11 H. du matin.

11 Novembre. - L'hôpital temporaire n°3 (Lycée) est évacué : il m'envoie ses 5 derniers blessés ou malades. 12 [novembre]. - Un personnage, chef des chevaliers de St- Jean, délégué de la Croix-Rouge, me prie de faire appliquer les règles de la Convention de Genève relatives au port du brassard par le personnel civil. Je le lui promets et prends des mesures en conséquence. Il me parle de mon arrestation en ville et me dit : Pourquoi ne sortez-vous pas en pékin ? Je lui réponds qu'un officier ne pouvait se livrer à ce genre de plaisanterie en temps de guerre devant ses subordonnés. Ce fut tout. A peine ce grand personnage est-il parti que le sous-officier de la Commandantur me communique l’ordre suivant : "Par ordre du général en chef, il est défendu au personnel civil et militaire de la Croix-Rouge du Lycée et de l'hôtel Dieu de sortir de leurs établissements". La veille j'avais adressé une demande d'autorisation de circuler librement en ville. - Il m'est donc interdit d’aller au Lycée prendre mes repas avec mes camarades. C’est la prison tout simplement. Toutefois le Dr Peyron continue à aller à la citadelle donner ses soins aux civils français. M. Predhomme obtient une heure de sortie le soir pour sa clientèle. C’est donc à la culotte rouge qu'on en veut. Le fait est que les habitants de Laon en étaient plutôt privés et la voyaient avec une joie à peine dissimulée. Inutile de dire, que privé de ma seule distraction : déjeuner et dîner au Lycée tout près d’ailleurs, à dater de ce jour j’eus le coeur bien serré surtout après le départ de tout le personnel de l’hôpital n° 3 qui eut lieu le 18 - puis Hudelbeerg - J’eus beaucoup de peine à pénétrer jusqu'à mes camarades pour leur serrer la main. Ils croyaient eux aussi traverser la Suisse pour rentrer en France

21 Novembre. - La Commandantur me fait établir un état des médecins-pharmaciens-Infirmiers employés à l'hôtel Dieu et le chiffre exact des malades qui y sont traités. On peut prévoir l'évacuation prochaine. Un officier de la Commandantur et de la Direction de Santé visitent nos salles en ma présence. En route pour la Captivité. Décembre 4. - 10 Heures du matin : Messieurs : Tenez-vous prêts à partir pour 1 heure sauf M. le pharmacien Cahen : le personnel infirmier y compris, bien entendu. Je passe rapidement dans les salles, fais mes adieux à nos blessés, leur recommande la bonne tenue, la correction et la résignation. A1 Heure 10 minutes un autobus pour les infirmiers et un omnibus à vitres peintes pour les médecins nous attendent ; nous sommes obligés de nous tenir debout dans ce véhicule dont on n'avait même pas enlevé les deux brancards. On nous presse vigoureusement. Je ne parlerai pas des adieux de notre personnel et des religieuses si dignes et si dévouées. Les moteurs ronflent depuis longtemps et nous partons à grande allure. Il saute aux yeux que les Allemands voudraient que notre départ passât inaperçu de la population ; il n'en fut rien et les braves habitants de Laon, malgré l'extrême vitesse des voitures trouvèrent le moyen de jeter à nos hommes et même à nous, des vivres, du vin, etc. Une bonne vieille jeta à nos soldats une pièce de 1 franc enveloppée soigneusement ! Je n'insiste pas. En très peu de temps nous sommes amenés au quai d'embarquement de l'Artillerie, à Chambry (2 kilomètres de Laon) en pleine campagne(…). » Le médecin major de 1ère classe Mestrude sera rapatrié en août 1915 après avoir séjourné aux camps de Giessen et de Friedberg.

fin